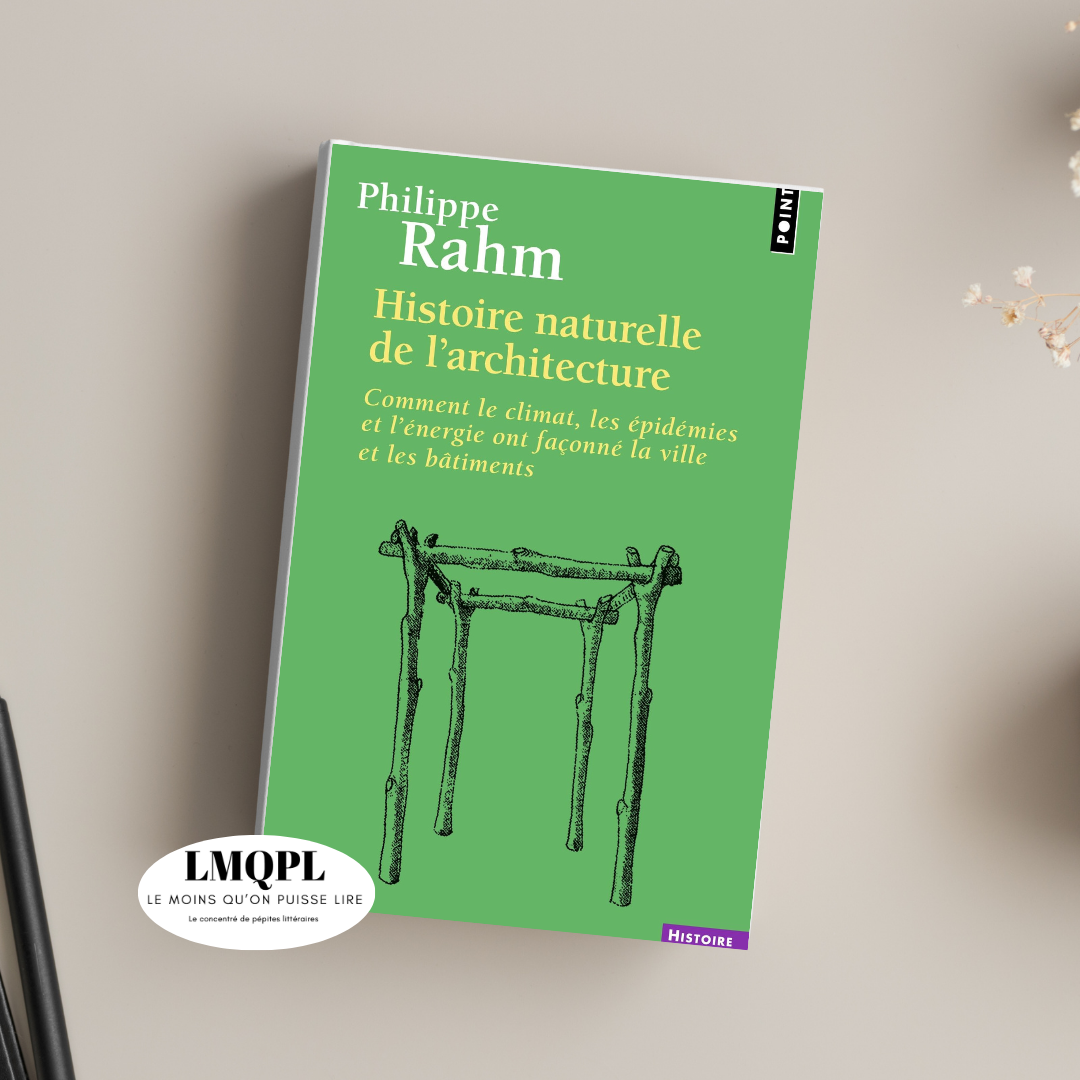“Histoire naturelle de l’architecture”, quand le vivant modèle les murs
Ce livre passionnant, que l’on doit au grand architecte suisse Philippe Rahm, propose une relecture de l’architecture par le prisme des forces naturelles. Un ouvrage qui permet de considérer autrement ce que l’on voit et édifie.
Par Camille Lefebvre
L’architecture n’est pas qu’une histoire de modes et de courants. Philippe Rahm nous explique comment, depuis la nuit des temps, les bâtiments se construisent pour une raison bien plus simple : protéger notre corps et maintenir sa température autour de 37 °C. Ce point de départ biologique devient la base d’une réflexion très profonde sur ce qu’est l’architecture.
Chaque chapitre du livre explore un lien surprenant entre un phénomène naturel et une évolution architecturale. On y apprend, par exemple, que les dômes du XVIIIe siècle sont nés de la peur des « miasmes », que les tapisseries servaient avant tout à isoler thermiquement les pièces, ou encore que la diffusion des vaccins a rendu possible le retour vers des centres-villes plus denses. Rahm nous pousse à voir des choses invisibles : l’air, la chaleur et le CO₂ s’avèrent être des matériaux d’architecture à part entière.
Un exemple marquant est celui des Biergarten allemands. À l’origine, ils n’ont pas été inventés pour des raisons sociales ou festives, mais thermiques : les brasseurs stockaient leur bière dans des caves souterraines qu’il fallait garder au frais. Pour cela, ils mettaient des graviers blancs sur le sol afin de réfléchir la lumière et plantaient au-dessus des arbres à larges feuillages qui créaient de l’ombre et faisaient baisser la température du sol. Petit à petit, ces lieux sont devenus des espaces publics accueillants, où les gens se sont mis à consommer sur place.
En école d’architecture, on apprend à faire attention à la lumière naturelle, à l’orientation, aux vents dominants. Mais là, il ne s’agit plus seulement d’optimiser : il s’agit de penser l’architecture comme une réponse physiologique et environnementale avant de mener son approche formelle. Ça remet en question l’ordre dans lequel on réfléchit. Ce n’est plus “Quelle forme est la plus intéressante ?” mais “Comment adapter cette forme aux conditions thermiques, sanitaires, atmosphériques ?””
Certains aspects du livre laissent un peu plus sceptique. Tout ne peut pas en effet s’expliquer par la biologie ou le climat. Loin d’être uniquement des réponses à des besoins thermiques, les choix architecturaux s’appuient également sur des désirs personnels ou des volontés symboliques, traduisant parfois aussi des intentions politiques ou sociales. Et il lui manque un peu de chair. Il parle des corps, mais rarement des personnes, des habitants, de leurs usages réels, de leur manière de s’approprier les lieux. Or, lorsqu’on apprend l’architecture, on nous incite justement à penser aux gens qui vivront nos projets. C’est néanmoins un livre essentiel car il offre des outils pour penser autrement. À une époque où la crise climatique remet en cause toute notre manière de concevoir, il rappelle que le projet architectural commence avec l’air que l’on respire, bien avant le trait que l’on trace...
Histoire naturelle de l'architecture, comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments , de Philippe Rahm, 13, 55 euros, Éditions Point Histoire