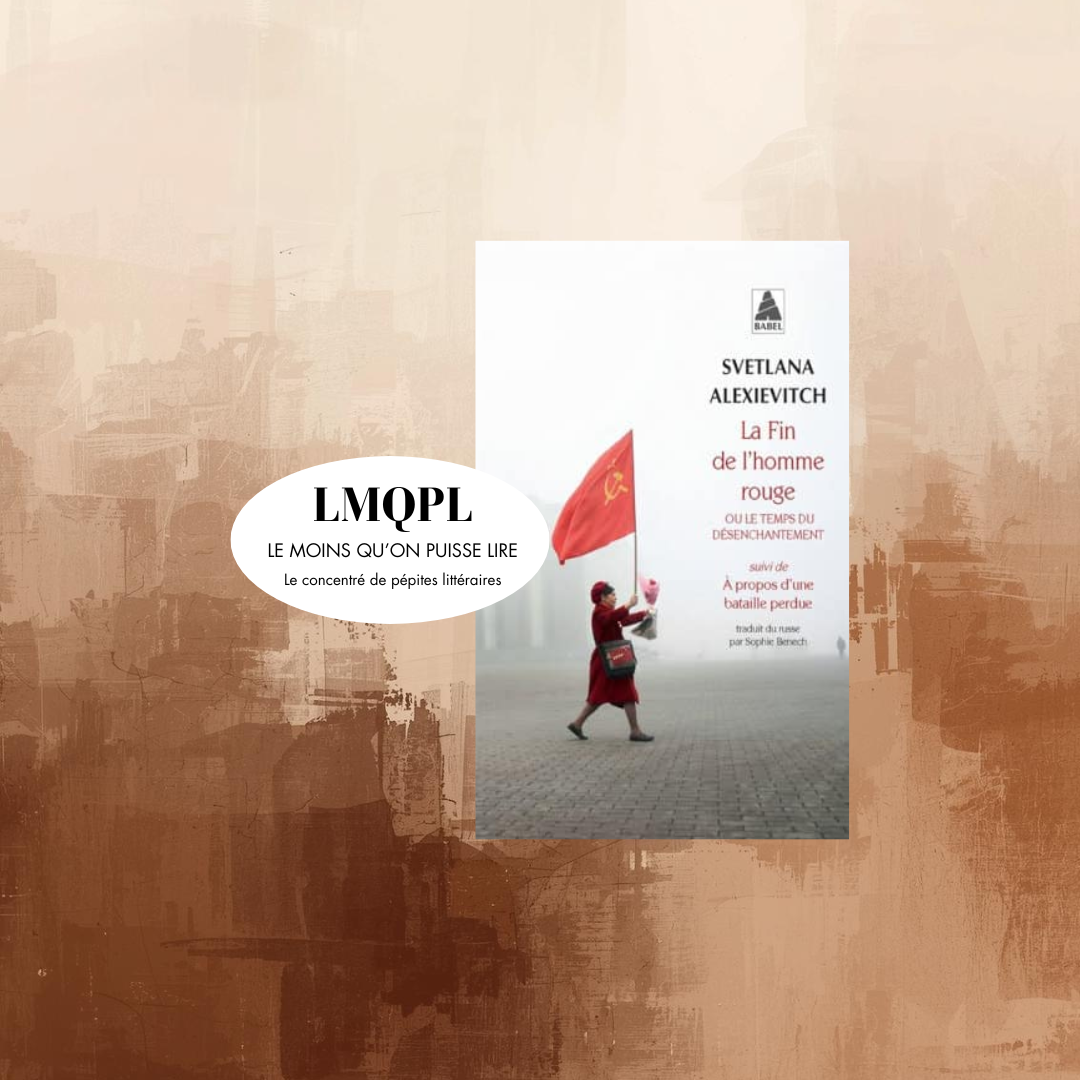Xavier Bouvet nous parle de “La Fin de l’homme rouge”
Par Bénédicte Flye Sainte Marie
Le primo-romancier, auteur du remarqué Bateau blanc paru il y a deux ans, a souhaité mettre en lumière l’opus magistral et vibrant de la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, auquel a été décerné le Médicis de l’essai en 2013.
“Il faut lire La Fin de l’homme rouge parce que c’est l’immense livre d’une immense œuvre, qui invente à lui seul son genre. Ni enquête, ni essai, ni recueil de témoignages, ni fiction : un « mémorial » qui tient de tous ces registres. Un poème, peut-être, une Iliade, le chant d’une colère.
J’avais été bouleversé par La Supplication, consacrée aux témoins de la catastrophe de Tchernobyl : veuve du premier pompier à avoir pénétré les lieux, kolkhoziens, responsables locaux, scientifiques… La Fin de l’homme rouge est également la composition de plusieurs dizaines de récits : exilés ou immigrés, femmes et hommes ordinaires, victimes et bourreaux, observateurs de la vie et de la chute d’un empire. Tous recueillis par Alexievitch au dictaphone, sédimentés, restitués dans sa langue simple, douce et mélancolique.
Je l’ai lu dans l’édition de poche de 2016 de Babel, qui comprend son discours d’acceptation du prix Nobel de littérature en 2015. « Je ne suis pas toute seule sur cette tribune », dit-elle. « Je suis entourée de voix, de centaines de voix, elles sont toujours avec moi. »
Au seuil de l’ouvrage, j’ai souligné cette phrase. « Nous ne connaissons pas notre pays. Nous ne savons pas à quoi pensent la majorité des gens. Nous les voyons, nous les croisons tous les jours, mais à quoi ils pensent, ce qu’ils veulent, nous n’en savons rien. Et pourtant nous nous permettons de leur faire la leçon. Nous n’allons pas tarder à tout savoir, et nous serons saisis d’horreur. ». Des vétérans de la Grande Guerre patriotique, fiers et anéantis, à ceux de Tchétchénie ; de la bestialité des camps au quotidien sinistre du régime, Alexievitch nous donne pourtant à voir aussi des êtres beaux d’amour et de souffrance, parmi lesquels Anna, arrachée à sa mère en déportation à l’âge de trois ans.
Au cœur de cette odyssée, émerge comme un chant de ralliement. Alexievitch explique, dans une page maintenant cornée : « Soit nous étions en guerre, soit nous nous préparions à la faire. Nous n’avons jamais vécu autrement. C’est de là que vient notre psychologie de militaires. Même en temps de paix, tout était comme à la guerre. On battait le tambour, on déployait le drapeau… Nos cœurs bondissaient dans nos poitrines. » À la fin de ce voyage infernal, un ancien combattant d’Afghanistan, détruit par l’alcool et la violence des hommes, a cette formule fulgurante : « La guerre, c’est quand on a envie de vivre. »
Des cuisines de l’ère soviétique, où l’on refaisait le monde tout en se préoccupant des vivres, Alexievitch passe aux rues de la capitale impériale déchue, dominée par les oligarques et les bandits des années 1990, ou vidée dans les années 2000 par le nouveau seigneur, Vladimir Poutine. Un jeune homme explique : « Moi, je fais partie des gens que l’oligarque envoie se faire foutre. Je viens d’une famille ordinaire. À leurs yeux, nous sommes de la merde, du fumier. Je vais à toutes sortes de rassemblements. De patriotes, de nationalistes. J’écoute. Un jour, quelqu’un me mettra forcément un fusil entre les mains. Et je le prendrai. »
Au fond, ce n’est pas un livre sur une fin mais sur notre temps. La clé est là, dans le discours de Stockholm de Svetlana Aleksievitch: « Le temps de l’espoir a été remplacé par le temps de la peur. Le temps est revenu en arrière. Nous vivons une époque de seconde main. »
La Fin de l'homme rouge, 12, 50 euros, Editions Actes Sud Babel
L’actu de Xavier Bouvet : L’auteur a publié en février 2024 son premier roman aux éditions Le bruit du monde Le bateau blanc, dépeignant un épisode névralgique, en septembre 1944, de l’histoire de l’Estonie, entre la fin de l’occupation allemande et l’incorporation forcée au bloc soviétique.