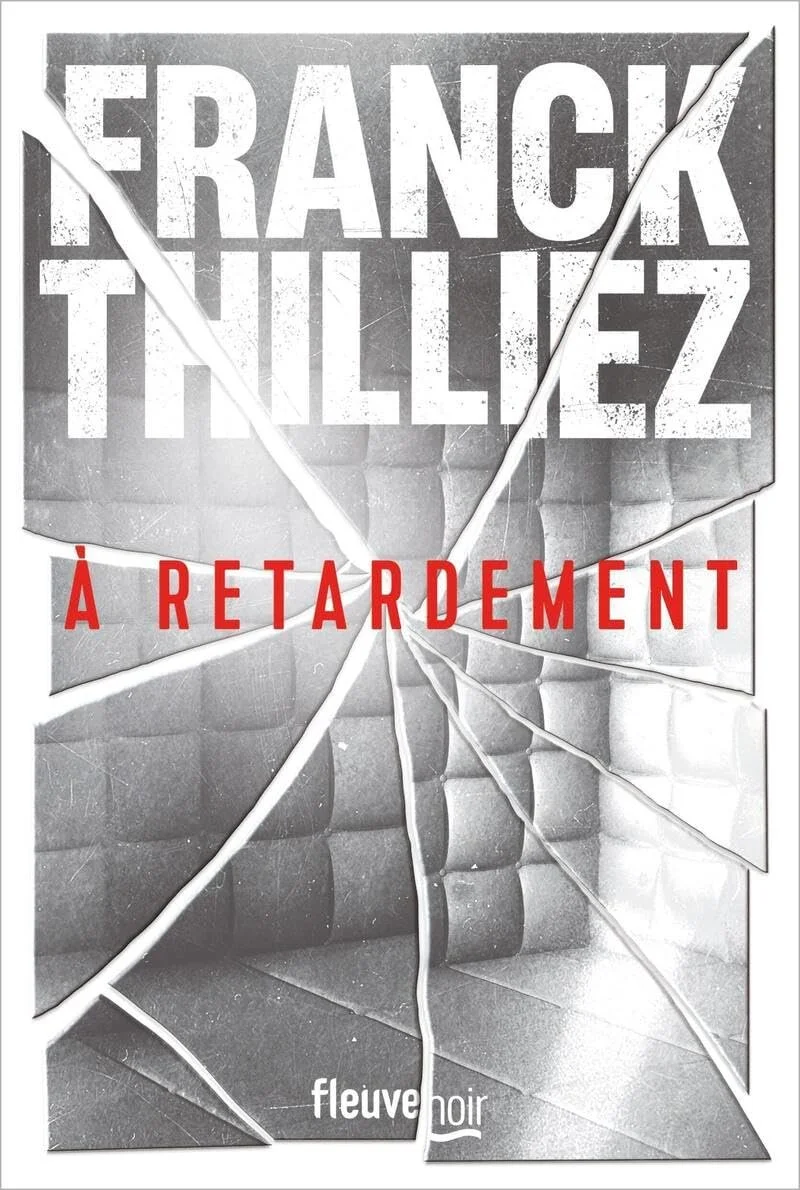Franck Thilliez : “Quand on ouvre la première page d’un livre, on rencontre un personnage et on doit avoir envie de le suivre”
Chacun de ses thrillers promet des sueurs froides. Dans A retardement, l’écrivain et scénariste nous plonge dans l’univers de la psychiatrie et dans les méandres d’un récit où s’entremêlent enquête policière, meurtres en série et schizophrénie. En exclusivité pour Le Moins Qu’on puisse lire, il revient sur son processus d’écriture, son exigence documentaire, ses personnages récurrents, et délivre avec générosité quelques secrets qui font la force de ses romans.
Propos recueillis par Odile Lefranc
Votre dernier opus A retardement prend pour cadre le monde de la psychiatrie. Qu’est-ce qui vous a décidé à en faire le noyau de votre intrigue ?
Ce qui m’intéresse dans le polar, c’est de comprendre comment une personne peut, du jour au lendemain, passer à l’acte : parfois de façon très calculée, parfois sous l’effet d’une pulsion ou d’un accès de folie. Dès qu’on écrit sur des meurtres, on touche forcément à la psychiatrie. Pour ce roman, j’ai voulu en faire la thématique centrale. C’est ma façon de travailler avec les « Sharko », mes enquêteurs : choisir un sujet et le développer sur tout le roman. Dans La Faille, c’était la mort. Mais il faut toujours un déclencheur. Ici, il est venu d’une discussion avec un copain psychiatre, qui m’a permis de visiter une unité pour malades difficiles (UMD) à Rouvray. Dès cet instant-là, j’ai su que ce serait le cœur du roman.
À la fin de votre livre, vous racontez qu’au moment de cette visite, vous n’aviez pas encore de trame précise. Comment cette expérience a-t-elle nourri la construction du roman ?
Je n’avais pas d’histoire détaillée. D’un côté, il y avait la psychiatrie, de l’autre mes enquêteurs. Mon point de départ restait vague : un malade mental commet un crime et se retrouve en UMD. La visite a tout changé. J’avais mille questions : comment soigne-t-on ? Quel est le lien avec la police ? Les patients sont-ils protégés ? Peuvent-ils sortir ? Chaque réponse m’apportait des éléments nouveaux, comblait mes manques et débloquait peu à peu l’intrigue.
Quel était l’intérêt pour vous de faire d’une psychiatre votre personnage principal ?
L’UMD n’a rien à voir avec l’hôpital public, où la pression du chiffre impose de soigner vite pour libérer des lits. Ici, il y a peu de malades et beaucoup de soignants. J’y ai rencontré des professionnels très dévoués, même face à des patients ayant commis des choses terribles. J’avais donc besoin d’un personnage issu de cette réalité... La psychiatrie, ce n’est pas seulement l’image du médecin qui distribue des médicaments. Il y a une dimension profondément humaine : tenter de saisir pourquoi la maladie existe, d’où elle vient et quelle en est l’origine.
Vous nous faites pénétrer à la fois dans l’UMD et dans la sphère mentale du malade, presque à l’intérieur de son cerveau, tout en conservant une juste distance. Comment atteint-on cet équilibre délicat ?
L’UMD est un lieu fermé, qui suscite curiosité et fantasmes. Il fallait éviter le sensationnel. Les soignants m’ont dit : « Venez, mais n’aggravez pas l’image qu’on a déjà de nous. » J’ai donc cherché à être respectueux et réaliste pour le personnel comme pour les patients. Appréhender ce qu’est réellement une maladie comme la schizophrénie était essentiel. Je voulais aussi changer la représentation effrayante que l’on se fait parfois des malades, perçus comme forcément dangereux alors que ce n’est pas toujours le cas.
« La psychiatre est elle aussi enquêtrice : elle entre dans la tête de ses patients et cherche à comprendre la maladie et son origine »
Pourquoi mettre en regard le milieu policier et la psychiatrie ?
Je voulais montrer comment la justice vient s’intercaler dans une enquête criminelle. Il est souvent question de responsabilité ou d’irresponsabilité, et beaucoup de gens acceptent mal qu’une personne ayant commis des meurtres ne finisse pas en prison. Dans le roman, le commandant Nicolas Bélanger incarne cette frustration : d’abord hostile à la psychiatre parce qu’il traque les « méchants », il la voit ensuite comme protectrice. Je voulais explorer ce dialogue difficile. La psychiatre est elle aussi enquêtrice : elle entre dans la tête de ses patients et cherche à comprendre la maladie et son origine.
Vous avez mis en exergue une phrase de Michel Foucault. Ses analyses sur la folie vous ont-elles influencé ?
Oui, je me suis beaucoup documenté sur le « grand enfermement » au XIXᵉ siècle. Au Moyen Âge, le « fou » faisait partie de la société : une personne extravagante dont on se demandait si ses paroles étaient divines ou maléfiques, mais il restait intégré. Puis est née la psychiatrie, avec ce « grand enfermement » : on a créé des asiles pour isoler les malades mentaux et une discipline pour les étudier. Aujourd’hui, on reste dans cette continuité : le « fou » reste mis à l’écart pour sécuriser la société. La psychiatrie actuelle n’est plus celle des années 1950, mais cette idée de séparation persiste.
Vos romans sont toujours très documentés. Comment se déroulent vos recherches ?
Elles font partie intégrante de mon processus d’écriture. Même si je n’écris pas encore mes chapitres, c’est là que le livre commence à se construire. Je publie un roman par an, et environ la moitié du temps est consacrée à cette phase : six mois pour poser les bases, rencontrer des gens, lire, collecter des informations et explorer des histoires ou faits méconnus, six mois pour écrire. L’UMD, par exemple, m’a donné plein d’idées. Une fois que je maîtrise suffisamment le sujet et mon histoire, je me lance dans l’écriture proprement dite.
De livre en livre, nous retrouvons vos enquêteurs-phares, à savoir Sharko et son équipe. Quel est votre secret pour garder ces personnages récurrents tout en renouvelant votre matière narrative ?
Ils ont l’avantage d’exister déjà, ce qui fait gagner beaucoup de temps d’écriture ! Le vrai défi, c’est de les faire évoluer, de les confronter à de nouveaux obstacles tout en maintenant l’intérêt des lecteurs qui s’y sont attachés. Quand on ouvre la première page d’un livre, on rencontre un personnage et on doit avoir envie de le suivre, comme s’il nous disait : « Bienvenue, cher lecteur ! Tu vas suivre mes aventures et je te garantis un moment formidable. » Il faut créer ce lien d’empathie, pour qu’il se reconnaisse dans le personnage et partage ses émotions et ses doutes. L’autre secret, c’est que ce protagoniste doit être profondément impliqué dans l’intrigue. Dans Angor, qui traite du don d’organes, la gendarme est elle-même greffée du cœur. Dans A retardement, la psychiatre devient malade elle aussi. Je cherche toujours à relier les personnages à l’enquête non seulement par les faits, mais aussi par leurs émotions et leur intériorité.
Votre style est souvent qualifié de très visuel, avec un rythme comparable à celui d’une partition musicale. Cette comparaison vous parle-t-elle ?
Oui, elle me plaît beaucoup. Un polar, c’est comme une symphonie : il faut des temps calmes, des montées en puissance, des paroxysmes, puis des respirations. Dans mes premiers romans, j’avais peur que le lecteur s’ennuie, je voulais que tout aille très vite, mais j’ai compris que trop de rebondissements tuent le rebondissement. Le lecteur a besoin de souffler pour mieux repartir.
À LMQPL, on aime tous les livres, notamment en format poche. Quel ouvrage de ce type nous recommandez-vous ?
Je dirais Misery de Stephen King. C’est le huis clos parfait, d’une intensité incroyable. J’ai passé mon adolescence à lire Stephen King. J’aime relire ce livre régulièrement. C’est toujours bien de se souvenir des auteurs qui nous ont influencés.
À retardement de Franck Thilliez, 22,90€, éditions Fleuve Noir.